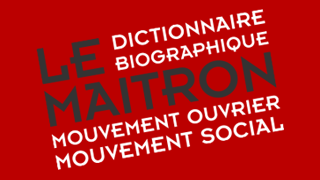Les chansonniers
Si quelques chansonniers révolutionnaires du XIXe siècle peuvent être considérés comme des artistes engagés, la plupart d'entre eux sont avant tout des militants politiques.
Pour eux la chanson est un moyen d'action parmi d'autres (la prise de responsabilités politiques, la rédaction de pamphlets, de textes idéologiques, la grève, la lutte armée...).
Une part importante des milieux populaires ne sait pas lire et la chanson est un moyen efficace de diffuser des idées.
Certains de ces auteurs ont une production exclusivement idéologique, d'autres ont écrit différents types de chansons.
Ils sont issus de milieux sociaux très divers, mais on compte peu de femmes parmi eux en France, jusqu'à une période récente. Cette quasi absence de femmes ne va pas de soi, car ce n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons où les chansonnières féministes protestataires sont nombreuses dès le XIXème siècle.
Progressivement, à partir des années 1890, les chansonniers sont de plus en plus professionnels (même si beaucoup vivent difficilement de leur art). Certains sont en lien avec des mouvements politiques révolutionnaires (ils publient dans la presse et se produisent à l'occasion de manifestations). Il leur arrive rarement d'écrire sur commande pour les partis politiques et leur engagement se limite le plus souvent au domaine artistique, ce qui n'est pas négligeable, car il s'agit d'affronter la censure et l'opprobre de la presse bourgeoise. En temps de guerre, les chansons sont souvent l'oeuvre de militants engagés.
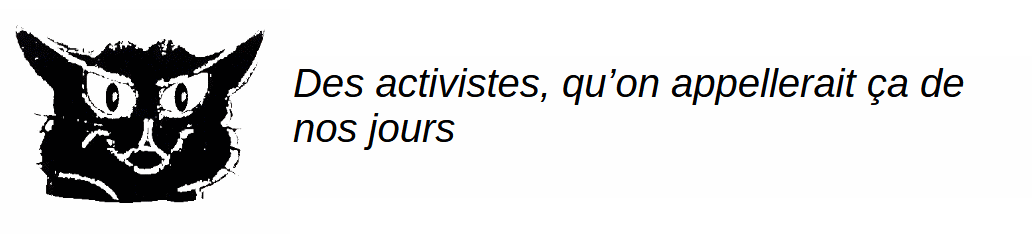
De son vrai nom Anton Amosov, il est issu d’une dynastie d’armateurs en Russie. Son père meurt alors qu’il est tout enfant et il connaît dans la vie des temps difficiles. Tantôt fonctionnaire, tantôt journaliste, il écrit sous pseudonyme des chansons internationalistes.
Archangelski (1854-1915)
Il nait dans un milieu favorisé. Néo-malthusien il préconise le contrôle des naissances, à la même époque qu’Emma Goldman aux États-Unis. Charles d’Avray est un compositeur prolifique. Lors de ses performances dans les cabarets parisiens, il présente ses chansons, considérant qu’il s’agit là d’une propagande efficace. Il parcourt ensuite la France, pour réaliser des "conférences anarchistes" sous forme de chansons. Il est encore actif dans les années 50 et fait le lien avec le renouveau de la chanson anarchiste d’après guerre.
Charles d’Avray (1878-1960)
Chansonnier à succès issu de la classe ouvrière, il se déclare proudhonnien. Ses textes engagés constituent cependant une petite part de son œuvre.
Eugène Baillet (1829-1906)
Alexis Bouvier (1936-1992)
Issu de la classe ouvrière, il commence sa vie professionnelle en tant que ciseleur sur bronze. Il se cultive car son désir est d’écrire. Fréquentant les goguettes, il acquiert rapidement du succès et devient chansonnier et romancier. Sa table a la réputation d'être bien garnie, mais il n'oublie pas ses origines. Son oeuvre traite essentiellement des conditions de vie difficiles du peuple.
D’origine bourgeoise, il fait de bonnes études, commence à écrire très tôt et acquiert rapidement une renommée internationale. Ses pièces de théâtre font scandale et indiquent chez leur auteur des penchants libertaires. Opposant au nazisme, il s'exile aux Etats-Unis. Après la seconde guerre mondiale, il revient vivre en Allemagne de l'Est. Trop indépendant d'esprit, il se heurte bientôt au régime.
Berthold Brecht (1898-1956),
Paul Brousse (1844-1929)
Il nait dans une famille bourgeoise, devient médecin, s’intéresse à la politique. Sans participer lui-même à la Commune, il est très impressionné par l’événement. Choqué par la répression de la semaine sanglante, il adhère à l’Internationale puis rallie les anti-autoritaires. Il devient un propagandiste important du mouvement. En 1873, il doit s’exiler, car l’État français dans le sillage de la Commune s’attaque aux Internationalistes. Pragmatique, Paul Brousse crée le parti "possibiliste", pour qui il s'agit de tirer tout ce qui est possible du capitalisme, sans attendre d'avoir réuni les conditions d'une hypothétique révolution. Il restera toute sa vie un militant socialiste et sera impliqué dans de nombreuses organisations internationalistes.
Né dans une famille bourgeoise qui connaît des revers de fortune, il doit interrompre ses études pour faire divers métiers. Amateur de théâtre, il connaît rapidement le succès dans les cabarets parisiens. Ses textes sont régulièrement publiés dans des revues libertaires, jusqu’à l’affaire Dreyfus. Ses prises de position contre le capitaine juif, lui vaudront l'hostilité des internationalistes.
Il est considéré comme l’un des fondateurs de la chanson réaliste et l’un des meilleurs poètes argotiques français.
Aristide Bruant (1851-1925)
Artiste, écrivain et militant ouvrier américain, il participe à la révolution mexicaine du côté de Zappata et occupe d’importantes fonctions syndicales au sein de l’I.W.W.
Ralph Chaplin (1887-1961),
Ses parents sont des meuniers aisés. Il quitte rapidement le domicile familial, est ouvrier, puis fréquente les cercles socialistes. Il écrit dans diverses publications et compose des chansons. En butte au pouvoir impérial, il doit s'exiler quelque temps en Belgique . Délégué du XVIIIe arrondissement au conseil de la Commune, il se bat sur la dernière barricade, se cache puis parvient à fuir la capitale. Après quelques années en exil à Londres, il revient en France où il vit dans la clandestinité avec sa famille. Lorsque les communards sont amnistiés, il reprend des activités politiques, adhère au Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire de Jules Guesde et organise des grèves et des mouvements ouvriers. Il milite jusqu'à sa mort. 5000 personnes assistent à son enterrement.
Jean Baptiste Clément (1836-1903)
Fils de meunier, après plusieurs boulots, il monte à Paris en 1998 dans l’espoir de vivre de ses poèmes. Ses débuts sont très difficiles, il vit dans la misère. Il collabore à plusieurs journaux anarchistes. Il est reconnu par certains chansonniers célèbres, mais malgré une certaine notoriété, il reste pauvre.
Gaston Couté (1880-1911)
Emile Dereux (1836-1871 ?)
Libraire à Montmartre, il combat comme canonnier dans la garde républicaine pendant le siège de Paris. Un Dereux, probablement le même, a cossigné l’« Affiche Rouge » qui dénonçait la trahison du gouvernement et appelait à la rébellion.
Johann Esser (1896-1971)
Tisserand puis mineur, il devient militant syndical et adhère au parti communisme allemand. Il devient écrivain et poète. Après la prise de pouvoir d'Hitler, il est envoyé au camp de concentration Börgermoor 3. Il reprend ses activités politiques et littéraires après la guerre puis prend ses distances avec le parti communiste stalinien.
Guy Debord (1931-1994)
Ecrivain, théoricien, cinéaste, poète et révolutionnaire français, il conceptualise la notion de spectacle dans le domaine socio-politique. Son travail sur la société du spectacle est, pour beaucoup considéré comme précurseur de la réalité de la société contemporaine. Il fait partie de l'Internationale Situationniste, qui critique la marchandisation du capitalisme.
Pierre Dupont (1821-1870)
Il est issu de la classe ouvrière. Ayant eu accès à l’instruction, il rencontre des académiciens et des intellectuels, ce qui assure la notoriété de ses chansons... Il participe à la révolution de 1848 et chante lors des banquets républicains dans les années précédant l'événement.
Sébastien Faure (1858-1942)
Issu d’une famille de la bourgeoisie conservatrice, il se destine à la prêtrise, mais reprend le négoce familial. À 27 ans, il se rapproche du parti ouvrier, puis à partir de 30 ans des antiautoritaires. Il devient un propagandiste de renommée internationale. Il donne des conférences avec Louise Michel, Kropotkine, Malatesta...
Au moment de l'affaire Dreyfus, il incite les anarchistes à prendre parti pour l'officier juif injustement accusé (de nombreux libertaires considéraient qu'il s'agissait d'une affaire interne à l'armée dont ils n'avaient pas à se mêler). Sébastien Faure se tourne ensuite vers l’éducation. Il fonde une école libertaire, la Ruche. Il est accusé de pédophilie. En 1914, il ne se rallie pas à l’union sacrée et reste résolument pacifiste.
Il nait dans la misère. Autodidacte, il fréquente très jeune les milieux libertaires. Il publie des poèmes, des articles de journaux, des essais et dessine dans des revues anarchistes. Son militantisme lui vaut de vivre dans la clandestinité, parfois le vagabondage, des séjours en prison, l’assignation à résidence ainsi qu’un exil en Angleterre et deux en France ou il milite au côté de Louise Michel.
Sante Ferrini (1874-1939)
Alfred Hayes (1911-1985)
Ecrivain et scénariste d’origine brittanique. Il a travaillé dans plusieurs pays.
De son nom complet Joseph Hillström, est un ouvrier itinérant d’origine suédoise, membre de l’Industrial Workers of the World, puissant syndicat anarchiste américain au sein duquel ses chansons et ses caricatures lui confèrent la notoriété. Il grimpe les échelons au sein de l’I.W.W., organisant des mouvements sociaux à travers tout le pays. Il est condamné à mort pour un crime qu’il n’a probablement pas commis, malgré une mobilisation internationale. L’accusation le charge en raison de son engagement militant. Il devient un martyr du syndicalisme étatsuniens et une référence pour une longue lignée de chanteu(r)euses engagé(e)s (Woody Guthrie, Paul Robeson, Pete Seeger, Joan Baez, Bruce Springsteen...).
Joe Hill (1879-1915)
Il est issu d’un milieu très modeste, travaille fort jeune comme garçon boucher et lit tant qu’il peut. Fréquentant les goguettes, il publie ses premières chansons à l’âge de vingt ans. Il est marqué par les événements de la Commune et son répertoire aborde les thèmes révolutionnaires
Après avoir exercé divers métiers tout en écrivant, décide de vivre de sa plume. Il collabore à plusieurs journaux. Malgré le succès (il ouvre sa propre goguette à la fin de sa vie), il vit pauvrement. Il meurt fou et confit dans l'absinthe.
Jules Jouy (1843-1897)
Charles Keller (1843-1913)
Originaire de Mulhouse, issu d’un milieu bourgeois, ingénieur, il devient directeur d’usine. Il a l’intention de publier un journal internationaliste et doit quitter son poste. Il se lie avec des militants anarchistes et fonde plus tard un journal dreyfusard.
dit Jacques Turbin
Résistant antifasciste communiste, écrivain et réalisateur allemand. Il compose cette chanson avec Johann Esser au cours de son internement au camp de Borgermoor 3.
Wolfgang Langhoff (1901-1966)
Louis Loréal (1894 -1956)
D'abord typographe, puis correcteur ; il est également chansonnier. Blessé lors de la première guerre mondiale, il fait un an de prison en 1918 pour « causerie pacifiste » ; en 1920, il fait dix-huit mois pour un tract antimilitariste. Il continue à militer dans les cercles anarchistes, se déclarant en faveur d'un pacifisme intégral. Lors de la seconde guerre mondiale, il publie des articles collaborationnistes.
Alex Mac Dade (1905–1937)
Ouvrier et poète, originaire de Glasgow. Il a combattu dans la 15eme brigade internationale durant la guerre d'Espagne. Il est commissaire politique dans le bataillon britannique. Il est blessé lors de la bataille de Jarama et tué le 6 juillet 1937, à la bataille de Brunete.
Constant Marie, dit « le père La Purge », déclare être devenu anarchiste après avoir effectué six mois de prison en 1866 pour vagabondage. Une blessure à la poitrine durant les combats de la Commune lui vaut d’échapper aux exécutions de la semaine sanglante. Il exerce divers emplois et milite dans de nombreux groupes anti-autoritaires à Paris au sein lesquels ses chansons lui valent un grand succès. Il est arrêté plusieurs fois.
Constant Marie (1838-1910)
Louise Michel (1830-1905)
Fille illégitime d’une domestique et du fils du châtelain, elle reçoit une bonne éducation. Infirmière, enseignante et révolutionnaire, elle prend une part active aux combats de la commune et déclare à la cour martiale, qui ne fait pas fusiller les femmes : « puisqu’il paraît que le plomb est tout ce que mérite un cœur épris de liberté, j’en veux ma part. Si vous n‘êtes pas des lâches, tuez-moi ». Le lendemain, elle fait la une des journaux et Victor Hugo lui consacre un poème.
Elle est condamnée à la déportation en Nouvelle Calédonie avec des centaines d’autres insurgés, c'est là qu'elle devient anarchiste. Inlassable militante révolutionnaire. Elle est également considérée comme une pionnière du féminisme bien qu'elle ne s'en soit jamais réclamée. Adulée par les uns, conspuée par les autres, elle est "la louve avide de sang", "la vierge rouge", "la petite sœur des pauvres", "la révolutionnaire impeccable", "la dévote de la révolution", "l'hystérique de l'égalité". Elle aura consacré toute sa vie à la cause. 100.000 personnes assistent à ses obsèques.


Elle demande à être enterrée au Père Lachaise, l'Etat l'envoie à Levallois Perret, une banlieue bourgeoise pour limiter les pèlerinages.
Montehus (1872-1952)
Gaston Mardochée Brunswick dit Montéhus nait dans le milieu de la bourgeoisie juive parisienne. Au départ socialiste modéré, il se radicalise en publiant des chansons antimilitaristes. Certaines lui vaudront des ennuis avec la justice. Montehus affirme "lancer ses chansons dans le peuple". Il est de fait extrêmement populaire, faisant salles combles partout en France. Ce succès le rend suspect dans les mouvements de la gauche radicale. On lui reproche de « faire du commercial », comme on dirait aujourd’hui. C’est assez injuste, car sans son immense popularité, il aurait sans doute eu moins de liberté d’expression. Lorsqu'éclate la première guerre mondiale, il se rallie à l'union sacrée, ce que certains camarades ne lui pardonneront jamais. Après la guerre, son répertoire redevient antimilitariste. Il se prononce en faveur du front populaire. On lui doit des chansons au succès considérable.
Henri Nadot (?-?)
Henri Nadot est un chansonnier français dont le répertoire n'est pas particulièrement révolutionnaire. Je n'ai pas trouvé grand chose sur lui.
Paul Paillette (1844-1920)
D’abord ouvrier ciseleur, il fréquente les cercles anarchistes parisiens à partir de 1883. Il participe à certaines actions et est fiché par la police. Il devient bientôt chansonnier et se produit dans de nombreux cabarets montmartrois. Ses chansons critiquent les préjugés bourgeois. Il est végétarien et partisan de l’amour libre. L’un de ses poèmes antimilitaristes sera censuré en 1916.
Felix Parades Camino (?-?)
Combattant républicain durant la guerre civile espagnole, il a passé la frontière française en février 1939
Issu d'une famille ouvrière conservatrice, ouvrier lui-même, c'est un excellent dessinateur sur étoffe et un militant politique. Il participe à la révolution de 1848. Chrétien au départ, il s'éloigne progressivement de la religion jusqu'à devenir franchement anticlérical. En 1870, il est à la tête d'une entreprise d'une vingtaine d'ouvriers tout en étant membre de la première internationale. Il est moblot (membre de la garde nationale) durant le siège de Paris et délégué du deuxième arrondissement durant la Commune.
Il parvient à échapper à la répression, il est condamné à mort par contumace, il gagne les Etats-Unis où il poursuit la lutte aux côtés des Francs-Maçons américains et organise la solidarité avec les communards déportés
De retour à Paris en 1880, à moitié paralysé et totalement sans le sou, il continue à fréquenter les cercles internationalistes. Sa révolte est intacte et il compose plus que jamais. Il ne vit pas de ses chansons qui sont restées très confidentielles durant sa vie. 10.000 personnes assistent à son enterrement.
Eugène Pottier (1816-1887)
Très tôt engagé politiquement, il devient anarchiste à la lecture de Louise Michel. Il fonde « le Père Peinard », un journal anarchiste fameux, pour son ton sarcastique et son langage argotique. Condamné à huit ans de prison pour avoir manifesté illégalement au côté de la "Bonne Louise" et avoir tenté de la protéger de la police. Il devient ensuite l’un des pionniers du syndicalisme révolutionnaire.
Emile Pouget (1860-1931)
Il nait en Allemagne, dans une famille social démocrate. Après la première guerre mondiale, à laquelle il participe, il publie des textes satiriques et des poèmes dans des revues de gauche et se produit dans des cabarets. Il est plusieurs fois censuré, avant même l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Il s'exile en Suisse, participe à organise la résistance antifasciste allemande, participe à la guerre d'Espagne, puis à la seconde guerre mondiale aux côtés des Russes. Il devient un personnage important en Allemagne de l'Est.
Erich Weinert (1890-1953)
Fille et femme de mineurs de charbon, militante syndicaliste américaine et chansonnière, elle est surtout connue pour la chanson "Which side are you on"
Florence Reece (1900-1986),
Né Estèva Roda Gil, c'est un auteur de chanson et un dialoguiste français. Il est aussi un militant libertaire, proche des anarcho-syndicalistes de la CNT.
Étienne Roda-Gil (1941-2004),
Henri Simoëns est un poète roubaisien du XIXe siècle, qui est né en 1841 et décédé en 1907. Elle est une chanson humanitaire qui dépeint les conditions de vie difficiles des travailleurs, notamment dans les milieux ouvriers, et a été particulièrement
Henri Simoëns (1841-1907)
Ecrivain et parolier. Il se consacre à la chanson populaire italienne. Il est surtout connu pour la chanson Bandiera Rossa.